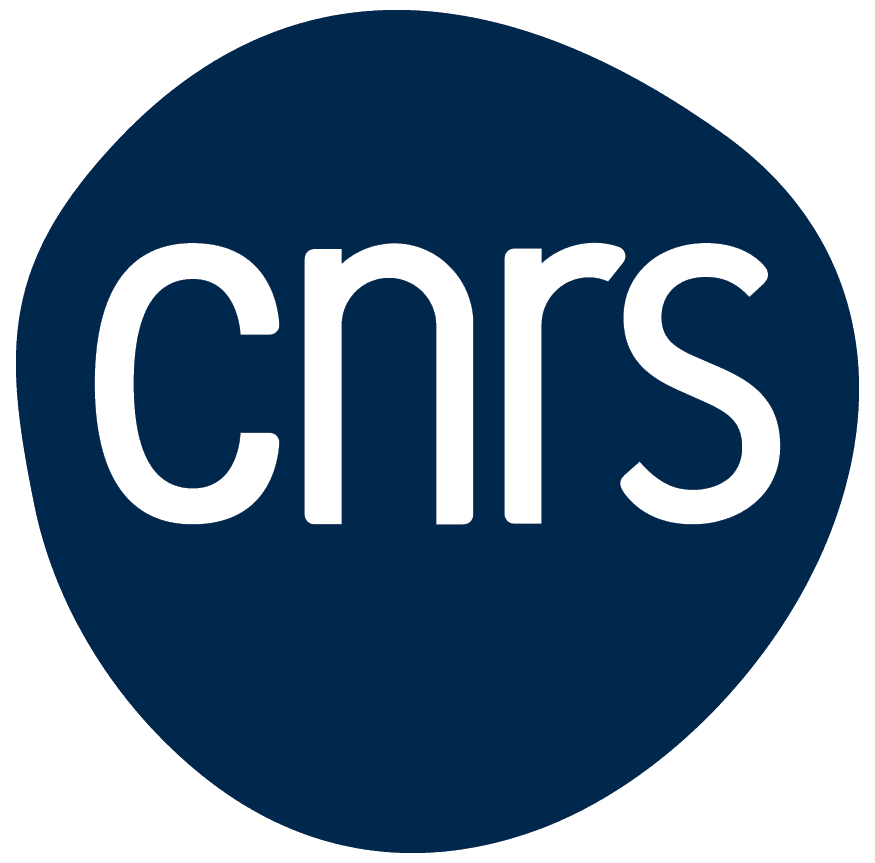Accueil>Contrats ANR
Contrats ANR
Respirer inégalement: Pollution atmosphérique, développement de l’enfant et reproduction de l’inégalité sociale: les données de la France (BREATHE)
Dans quelle mesure le magnétisme environnemental permet-il une bio-surveillance pertinente de la pollution de l’air aux particules fines en milieu urbain et péri-urbain ? L’intégration des citoyens depuis une métrologie sur bio-capteurs jusqu’à la construction d’un plan d’action peut-elle servir de levier sur les décisions politiques qui concernent la qualité de l’air ? Ces deux questions sont au cœur du projet BREATHE. Pour y répondre, nous mettrons en œuvre un programme de Science Citoyenne de bio-surveillance par les techniques du magnétisme environnemental qui puisse servir de base solide à un programme de Recherche-Action Participative. L’enjeu est d’intégrer pleinement le citoyen dans la construction et la mise en place des politiques publiques des territoires sur la qualité de l’air. Sur le plan de la métrologie, l’avantage du projet BREATHE est sa capacité à produire, grâce à la technique employée, un grand nombre de mesures rapides et peu chères prenant en compte la présence de nanoparticules. Ces caractéristiques permettent une production de cartes singulières à haute résolution spatiale des dépôts de polluants selon des modi operandi intégrant les citoyens. Tout le défi de BREATHE sera de porter la technique du magnétisme environnemental sur biomatériaux à un niveau de validation qui permette de l’utiliser in fine dans la co-construction d’une part d’outils d'aide à la décision intégrant des indicateurs d'efficacité afin de mettre en œuvre plus efficacement les politiques publiques sur la qualité de l’air et d’autre part de feuilles de route pour les réformes métrologiques et institutionnelles.
Nous avons ciblé trois zones tests sur lesquelles il existe à la fois une source potentielle bien identifiée de pollution anthropique aux particules fines et une mobilisation déjà bien avancée en amont du projet BREATHE depuis le citoyen jusqu’aux élus. Ces trois zones tests correspondent à la commune de Saint-Aunès riveraine d’une autoroute à 12 voies de circulation, aux communes de Valergues et Mauguio directement concernées par les rejets d’une usine de valorisation des déchets, et à plusieurs rues « canyons » en milieu urbain dans la ville de Toulouse. L’ambition de BREATHE est de développer avec et pour le citoyen une méthode qui puisse être déployée sur différents territoires et à différentes échelles. Ce projet a reçu le soutien de la société privée ASF/VINCI qui a financé le développement et la réalisation d’un banc expérimental pour étalonner la mesure des dépôts de polluants sur les végétaux, et du soutien des communautés territoriales concernées, Toulouse Métropole et Agglomération du Pays de l’Or. BREATHE est un projet hybride qui s’inscrit résolument et modestement à son échelle dans les outils pour relever les défis de la transition écologique et solidaire.
Responsable scientifique au CRIS : Lidia Panico. Durée du projet : 01/10/2024 - 30/09/2028.
Partenaires :
- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) - Délégation Régionale Rhône-Alpes Auvergne
- Institut National d’Études Démographiques (INED)
- École d’Économie de Paris (PSE)
Télétravail et inégalités d’offre de travail et emploi du temps des ménages (WHIN)
Le travail à domicile est en plein essor et on prévoit qu'il restera répandu à l'avenir. Cela a des implications pour la vie quotidienne des ménages, le bien-être et les inégalités qui ne sont pas encore complètement comprises. Depuis la pandémie de Covid, le travail à domicile est répandu au sein de l'OCDE, avec un travailleur sur cinq travaillant au moins un jour par semaine à domicile en France. La plupart des travailleurs peu qualifiés n'ont cependant pas l'opportunité de travailler à domicile, tandis que les emplois peu qualifiés sont détruits en raison du décalage spatiale. Il est difficile de prédire a priori si la diffusion du travail à domicile peut contribuer à réduire les écarts entre les sexes dans le travail rémunéré et non rémunéré, profondément enracinés dans les normes culturelles de genre, ou plutôt ajouter aux inégalités au sein et entre les ménages dans l'utilisation du temps. À ce jour, il n'existe pas de modèle théorique de prise de décision des ménages tenant compte du travail à domicile. Ce projet vise à combler ces lacunes dans la littérature. L'objectif est de développer un modèle théorique de prise de décision des ménages tenant compte de la possibilité de travailler à domicile, et qui s’inspirerait des modèles collectifs, de la théorie des transmissions culturelles et de la sociologie de l'utilisation du temps. Nous fournirons de nouveaux résultats empiriques pour un groupe sélectionné de pays, différents en termes de normes culturelles de genre, de structure industrielle et de diffusion du travail à domicile : la France, l'Italie, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce projet abordera la question du travail à domicile, sous l'angle de l'allocation du temps des ménages et des normes culturelles de genre et dans le cadre d'une approche multidisciplinaire, en éclairant les retombées pour les inégalités entre les sexes et sociales.
Responsable scientifique au CRIS : Laurent Lesnard. Durée du projet : 01/10/2024 - 30/09/2029.
Partenaires :
- École d’Économie de Paris (PSE)
- Université de la Réunion
- CY Cergy Paris Université
Classe, communauté et contexte dans la diffusion de la désinformation à l’ère numérique (ACTIVEINFO)
What shapes whether people receive, believe, and share disinformation? The rise of “fake news” has become an area of deep concern worldwide, potentially threatening everything from political elections and vaccine acceptance to the current war in Ukraine. The online spread of disinformation raises questions more broadly about the role of information in democratic societies, with more and more people engaging with news online and in a variety of formats. Despite a dramatic increase recently in disinformation research, a crucial and remaining puzzle is that a large number of people believe fake news claims while only a small number of people (often below 1%) consume fake news in their daily news diet (Allen et al. 2020; Fletcher and Nielsen 2018; Grinberg et al. 2019; Tsfati et al. 2020). How and why do people report that they trust unverified information if they are not actually consuming this news directly? To understand this empirical disconnect in the process of the diffusion of disinformation in the digital era (3Ds), this mixed-methods research advances the state of the art that selects on the dependent variable of digitally visible fake news and top-down levers of distribution. Existing scholarship tends to skew toward top-down powerful players: platforms (like Twitter), politicians (like Putin), or policies (like the GDPR). This extant research has yet to fully examine the broader array of everyday bottom-up active media practices and mechanisms of sharing—or not sharing. Instead, ACTIVEINFO, an interdisciplinary (sociology and communication) and mixed-methods project, will uncover how information – both fake news and otherwise – circulates in the digital media environment and in offline spaces. Taking a deeply contextualized approach, I will harness the power of a two-country comparison based to examine how class, community, and context shape information flows to help answer this puzzle.
Responsable scientifique: Jen Schradie. Durée du projet : 01/10/2022 - 30/09/2026.
Partenaires :
- Northeastern University (David LAZER)
- UNC Chapel Hill (Daniel KREISS)
- Université Paris Saclay (Paola TUBARO)
Pratiques des publics des plateformes de Streaming musical (RECORDS)
Que fait le streaming à notre écoute de la musique ? Que disent les big data collectées par les plateformes de streaming de nos pratiques d’écoute musicale ? Comment les consommations de contenus musicaux et les pratiques d’écoute évoluent-elles à l’ère de l’abondance de l’offre et de la recommandation ? L’hyperchoix donne-t-il lieu à des parcours individuels très dissemblables ? Ces plateformes favorisent-elles essentiellement des écoutes d’« accompagnement » des activités quotidiennes, organisées par les playlists ? Les traces collectées par les plateformes permettent-elles de revisiter les théories de la sociologie des pratiques culturelles ?
Les réponses existantes à ces questions sont aujourd’hui très partielles. Les enquêtes par questionnaire peinent à appréhender en finesse les pratiques d’écoute, au-delà des préférences générales déclarées; les travaux basés sur des entretiens sont centrés sur l’expérience d’une population restreinte, souvent très engagée dans la pratique musicale, et ne sauraient tracer l’ensemble des écoutes; les travaux à partir de données d’écoute manquent de pouvoir explicatif, faute d’information sur les internautes.
Le projet RECORDS propose d’articuler enquête et big data, et d’étudier les questions précédentes à partir d’un matériau empirique d’une diversité et d’une ampleur sans précédent. Il s’appuie sur un partenariat original entre des chercheurs issus des sciences sociales, des sciences du numérique, et l’un des acteurs majeurs de la diffusion musicale en France. Il représente une opportunité unique que seule permet la collaboration de la recherche publique avec une entreprise privée : celle de constituer un corpus articulant les informations déclarées des individus avec l’intégralité des traces de leurs écoutes sur une plateforme depuis plusieurs années. Les chercheurs disposeront ainsi, pour plusieurs milliers d’individus, de données recueillies avec le consentement des utilisateurs, permettant d’analyser conjointement l’ensemble de leurs écoutes réelles, leurs pratiques et goûts déclarés, leurs caractéristiques socio-démographiques et des éléments biographiques tels que les rythmes de vie.
Ce corpus inédit permettra d’approfondir la compréhension de l’écoute musicale en streaming, considérée comme un cas emblématique et précurseur de la consommation culturelle en régime numérique : (1) en explorant de nouveaux modes de représentation de la circulation des œuvres et des personnes au sein des espaces musicaux, et en confrontant ces représentations à celles que s’en font les utilisateurs; (2) en réexaminant la stratification sociale des goûts musicaux et la théorie de l’omnivorisme culturel à la lueur des traces d’écoutes réelles des personnes, en caractérisant de façon multiple les patterns de diversité consommée; (3) en mesurant le rôle des contextes et des caractéristiques sociales sur les pratiques d’écoutes, notamment sur les usages de la recommandation et ses effets. Tirant parti de travaux récents en apprentissage automatique, RECORDS viendra en retour enrichir ces méthodes qui sont à l’œuvre dans les approches actuelles de la recommandation.
Les résultats scientifiques attendus du projet sont ainsi tant méthodologiques, à travers de nouveaux modes de calcul et outils de visualisation de la circulation des personnes dans des espaces de goût, que théoriques, dans le renouvellement des théories de la consommation musicale et la compréhension inédite des ressorts de l’usage ou non des algorithmes. Ils dessineront une vision informée, réaliste et complète des pratiques du streaming musical, au-delà des images de l’exploration illimitée ou de la manipulation par les automates de recommandation. Le bénéfice industriel attendu du projet est directement lié à l’exploitation de ces connaissances nouvelles pour améliorer les plateformes et étoffer leur compréhension des envies de leurs utilisateurs.
Responsable scientifique au CRIS : Philippe Coulangeon. Durée du projet : 01/10/2019 - 31/12/2025.
Partenaires :
- Géographie-Cités
- Centre Marc Bloch
- Deezer
- Orange